Logement des personnes aînées : l’urgence d’un virage social
La crise du logement fait couler beaucoup d’encre depuis quelques années. Et avec raison. Elle est l’un des enjeux sociaux les plus pressants auxquels nous faisons face. Ses effets se font sentir à travers toutes les régions du Québec, et toutes les tranches de la population en ressentent les impacts, des plus jeunes aux plus âgées.
Des loyers qui explosent, un filet social qui s’effrite
Cela étant dit, elle ne peut être abordée comme une simple question technique ou conjoncturelle. Elle s’inscrit dans une trajectoire historique marquée par la financiarisation de l’habitation, le sous-financement chronique du logement social et l’érosion progressive du droit au logement comme droit fondamental.
En 1991, les logements sociaux représentaient 6,2 % du parc immobilier au Canada, contre 4,1 % en 2021, selon le Bureau du directeur parlementaire du budget1. Cela survient en même temps que les prix des loyers explosent : au Québec, pour un appartement de deux chambres à coucher, le loyer moyen selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) était de 815 $ à la fin de 2019 et de 1131 $ à la fin de 2024. Autrement dit, on parle d’une hausse de 39 %2.
Sans grandes surprises, son impact sur les personnes aînées est déjà grave. Selon l’Observatoire québécois des inégalités3, c’est le quart (24 %) des ménages composés de personnes âgées de 65 ans et plus qui habitent dans un logement qui n’est pas jugé acceptable, c’est-à-dire qui ne correspond pas aux trois normes établies par la SCHL sur le plan de l’abordabilité, de la taille convenable et de la qualité du logement.
Les aînés plus pauvres en première ligne de la précarité résidentielle
De nombreux aînés et aînées n’ont pas eu, au cours de leur vie, l’opportunité d’acquérir une propriété ni de cotiser à une épargne-retraite ou à un fonds de pension. Ils dépendent aujourd’hui de revenus fixes provenant de programmes publics tels que la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV), le Supplément de revenu garanti (SRG) et le Régime de rentes du Québec (RRQ). Ces prestations, bien qu’essentielles, peinent à suivre l’augmentation rapide du prix des loyers.
Cela, c’est sans compter les rénovictions. Ces expulsions déguisées, justifiées par des travaux majeurs, servent souvent à contourner les règles encadrant les hausses de loyers. Or, dans un contexte de rareté, une personne aînée évincée de son logement perd rarement seulement un toit – elle perd aussi ses repères, son réseau de voisinage, parfois même son autonomie. Les protections juridiques demeurent insuffisantes pour prévenir ces abus, et les aînés, souvent moins au fait de leurs droits ou moins enclins à contester devant le Tribunal administratif du logement (TAL), sont particulièrement vulnérables.
Le phénomène, bien documenté à Montréal, s’étend aussi aux villes de moyenne taille et commence à toucher les régions.
Évidemment, pour ces personnes, les RPA ne sont pas une option. Selon des données de 2025, à Montréal, le coût moyen d’une chambre individuelle en RPA est de 2 500 $ par mois4. Pour un studio, on parle de 1 800 $. Un appartement d’une chambre peut monter jusqu’à 2 250 $, et un appartement de deux chambres ou plus environ 3 100 $. Les coûts des logements avec soins sont hors de portée pour plusieurs. On parle de montants de 4 450 $ par mois à Montréal.
Ces montants dépassent souvent les revenus de retraite des personnes aînées, les obligeant à puiser dans leurs économies ou à solliciter l’aide de leurs proches.
De plus, le financement public privilégie souvent ces établissements privés au détriment des services de soutien à domicile. Par exemple, le budget provincial 2024-2025 alloue 1,6 milliard de dollars sur sept ans pour les RPA, contre seulement 116 millions de dollars par année pour le soutien à domicile, une somme jugée insuffisante pour répondre à la demande croissante.

Un calcul qui accentuera les inégalités
Les choses ne vont pas s’améliorer de sitôt, malheureusement. La ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a modifié la méthode de calcul pour les hausses de loyers, qui désavantagera les locataires. Il faut comprendre que depuis les années 1980, le TAL utilisait 13 indicateurs économiques pour calculer l’augmentation des loyers, incluant des éléments sensibles comme le coût du logement. Mais à partir de 2026, ce calcul sera modifié pour être rendu plus simple : il ne va prendre en considération que quatre indicateurs, dont une moyenne mobile de l’Indice des prix à la consommation (IPC) au Québec sur trois ans, ce qui reflètera l’évolution du coût de la vie de manière plus lissée.
Bien que la volonté de simplifier le calcul soit justifiable, il faut comprendre qu’aucune équation n’est neutre en économie. Les biais politiques modèlent toujours l’environnement social, que ce soit dans le sens d’un groupe ou d’un autre. En mettant de l’avant ce calcul, la ministre Duranceau a pris le parti des propriétaires plutôt que celui des locataires en imposant un taux fixe sur les hausses de loyer que les propriétaires peuvent décréter lorsqu’ils effectuent des travaux. Au lieu de varier en fonction de l’économie, ils seront fixés à 5 % du montant par année. Considérant que 60 % des logements ont été construits avant 1990, et que plusieurs sont vétustes et énergivores, les rénovations à venir ouvriront assurément la porte à des hausses importantes de loyers.
L’impératif de reconnaître le logement comme un droit et non comme un objet de spéculation
Dans ce contexte, le risque est grand que les personnes aînées soient laissées pour compte. Invisibilisées dans les discours dominants sur la crise du logement, elles vivent pourtant une forme de précarité silencieuse, faite de renoncements et d’isolement. Pour plusieurs, ce n’est plus une question de confort mais de survie : rester dans un logement inadapté ou trop cher, ou être contraint ou contrainte de déménager loin de son réseau, de ses services de santé, de ses repères.
Face à cette réalité, il est impératif d’agir autrement. Il faut cesser de traiter le logement comme une marchandise et le reconnaître pleinement pour ce qu’il est : un droit fondamental. Cela exige un engagement clair de l’État pour développer massivement du logement social, coopératif et communautaire destiné aux personnes aînées. Il faut exiger un financement adéquat des soins à domicile. Et il faut aussi commencer à penser à soutenir des modèles innovants, par exemple des fiducies foncières communautaires et des habitats autogérés.
Vieillir dans la dignité, c’est aussi pouvoir habiter un logement stable, sécuritaire, accessible, à proximité de son milieu de vie. Pour les personnes aînées, c’est aussi être reconnues comme des citoyens et citoyennes à part entière. Un Québec qui se prétend humain et solidaire ne peut détourner les yeux devant cette injustice.
Il est temps de réaffirmer ce principe simple : le droit au logement ne diminue pas avec l’âge. Il ne fait que devenir plus urgent.
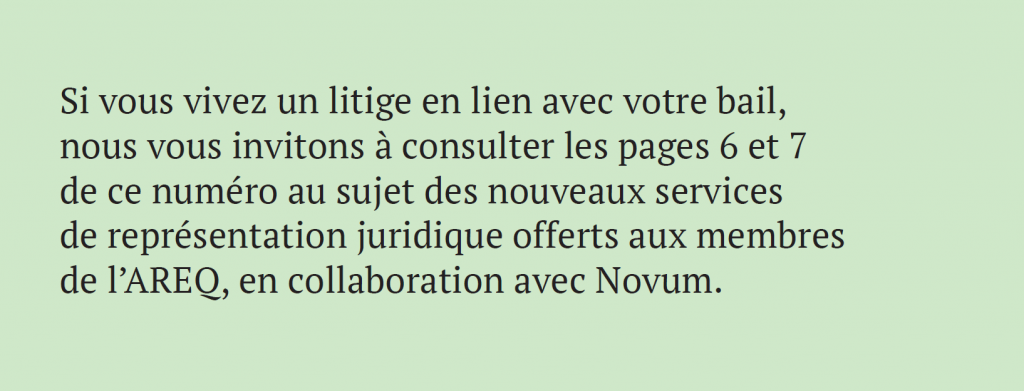
1 https://www.pbo-dpb.ca/fr/additional-analyses–analyses-complementaires/BLOG-2425-008–evolution-canada-social-housing-stock–evolution-parc-logements-sociaux-canada
2 Tableaux de données tirés de l’Enquête sur les logement locatifs | SCHL
3 https://observatoiredesinegalites.com/vieillir-chez-soi-un-souhait-menace-par-la-crise-du-logement/
4 https://www.vivreenresidence.com/blogue/prix-residences-pour-aines-2025-couts-au-quebec/?utm_source=chatgpt.com


