Regard sur 50 ans d’évolution en matière de condition féminine au Québec
Le Conseil du statut de la femme (CSF) a été créé en 1973 par le gouvernement du Québec avec pour mission de « donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui concernent l’égalité et le respect des droits et du statut de la femme ». Cinq ans plus tard, il rend public un avis intitulé Pour les Québécoises : égalité et indépendance, dans lequel il fait le point sur la condition féminine au Québec et formule 306 recommandations pour favoriser l’égalité entre les sexes.
À l’occasion du 50e anniversaire de sa création en 2023, le CSF a souhaité revisiter l’état de situation décrit dans son avis de 1978 afin de mettre en lumière des avancées, mais également des enjeux persistants ou transformés au fil du temps en matière de condition féminine. C’est ainsi que le bilan rétrospectif L’égalité entre les femmes et les hommes : Regard sur 50 ans d’évolution au Québec a vu le jour.
Dans les lignes qui suivent se trouve un aperçu du contenu des cinq chapitres du bilan, les mêmes que ceux de 1978, qui se déclinent en deux volets. Cet aperçu est d’abord précédé d’un retour sur les problèmes observés et les principaux leviers proposés par le Conseil en 1978. Le dossier met ensuite en relief des données ou des faits marquants qui témoignent des avancées et des enjeux persistants ou émergents.
Socialisation et stéréotypes sexuels
Dans le premier chapitre de son avis de 1978, le CSF constate une démarcation des rôles masculins et féminins dans la répartition des tâches domestiques. Les pères s’impliquent peu dans l’éducation et les soins aux enfants. En matière de scolarisation, le CSF met en évidence l’importance de la période scolaire comme une étape majeure de la socialisation des jeunes, déplorant la surreprésentation des femmes dans l’enseignement primaire et leur sous-représentation dans les postes de direction et à l’enseignement supérieur. Il critique le contenu des manuels scolaires et les publicités dans les médias qui véhiculent des stéréotypes sexistes, le rôle des femmes étant souvent limité aux tâches domestiques, et leur apparence physique survalorisée.
Depuis 1978, des progrès ont été réalisés, notamment avec le Régime québécois d’assurance parentale, qui offre depuis 2006 des congés réservés exclusivement aux pères. Toutefois, les mères consacrent toujours plus de temps que les pères aux soins des enfants et aux tâches domestiques. En ce qui concerne les manuels scolaires, le ministère de l’Éducation a donné suite à la recommandation du CSF en créant en 1980 le Bureau d’approbation du matériel didactique, qui tient compte de la manière dont les femmes et les hommes sont représentés.
Santé
Le deuxième chapitre de l’avis de 1978 porte sur divers aspects de la santé des femmes. En 1978, l’avortement est considéré comme un crime, sauf si la santé de la femme est en danger. On constate aussi une insuffisance du dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus. La sédentarité des femmes est préoccupante, tout comme la popularité des produits minceur. Le CSF aborde aussi les notions de violence conjugale et de viol. Ce dernier n’est d’ailleurs pas considéré comme un crime s’il est commis à l’intérieur du mariage, et il n’existe aucune statistique sur les violences subies par les femmes.
La réforme du Code criminel de 1983 aura pour effet de remplacer la notion de viol par celle d’agression sexuelle. L’agression sexuelle au sein d’un couple marié est reconnue et peut être punie.
Depuis 1988, l’avortement n’est plus considéré comme un crime. Un programme de dépistage du cancer du sein voit le jour en 1998, et des lignes directrices sur le dépistage du cancer du col utérin sont instaurées. Quant à la culture de la diète, elle est encore bien présente, tout comme la grossophobie, avec laquelle les femmes doivent composer dans la société actuelle.

Famille
Dans le troisième chapitre de l’avis de 1978, le CSF s’intéresse à la famille. Il critique la dépendance des femmes dans le mariage, surtout après un divorce, qui les laisse souvent dans une insécurité financière. Il réclame qu’une pension alimentaire soit versée en cas de rupture pour permettre à la femme de recouvrer son autonomie et souligne la nécessité de créer un réseau de garde universel pour faciliter leur retour au travail.
Depuis, d’importantes réformes ont eu lieu : l’égalité juridique des sexes dans le mariage (1980), la création de politiques familiales (1988) et d’un patrimoine familial, en 1989. Le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance voit aussi le jour en 1997.
Marché du travail
Dans le quatrième chapitre de l’avis de 1978, le CSF examine la participation des femmes au marché du travail. Il déplore que le travail rémunéré des femmes soit considéré comme un salaire d’appoint. L’accès des femmes aux études supérieures est restreint et on constate aussi une discrimination à l’embauche et dans l’octroi de promotions. Un écart salarial persiste aussi entre les femmes et les hommes pour l’exercice d’un même emploi.
Depuis 1978, les femmes sont plus scolarisées que les hommes, et il y a une mixité dans plusieurs secteurs d’emploi. Toutefois, les femmes sont encore surreprésentées dans les emplois du « prendre soin » et sous-représentées dans les secteurs de la science et de la construction. En 1996, on instaure la Loi sur l’équité salariale, et l’écart salarial passe de 17 % en 1998 à 10 % en 2022. Néanmoins, les revenus des travailleuses demeurent, aujourd’hui encore, moindres que ceux des travailleurs.
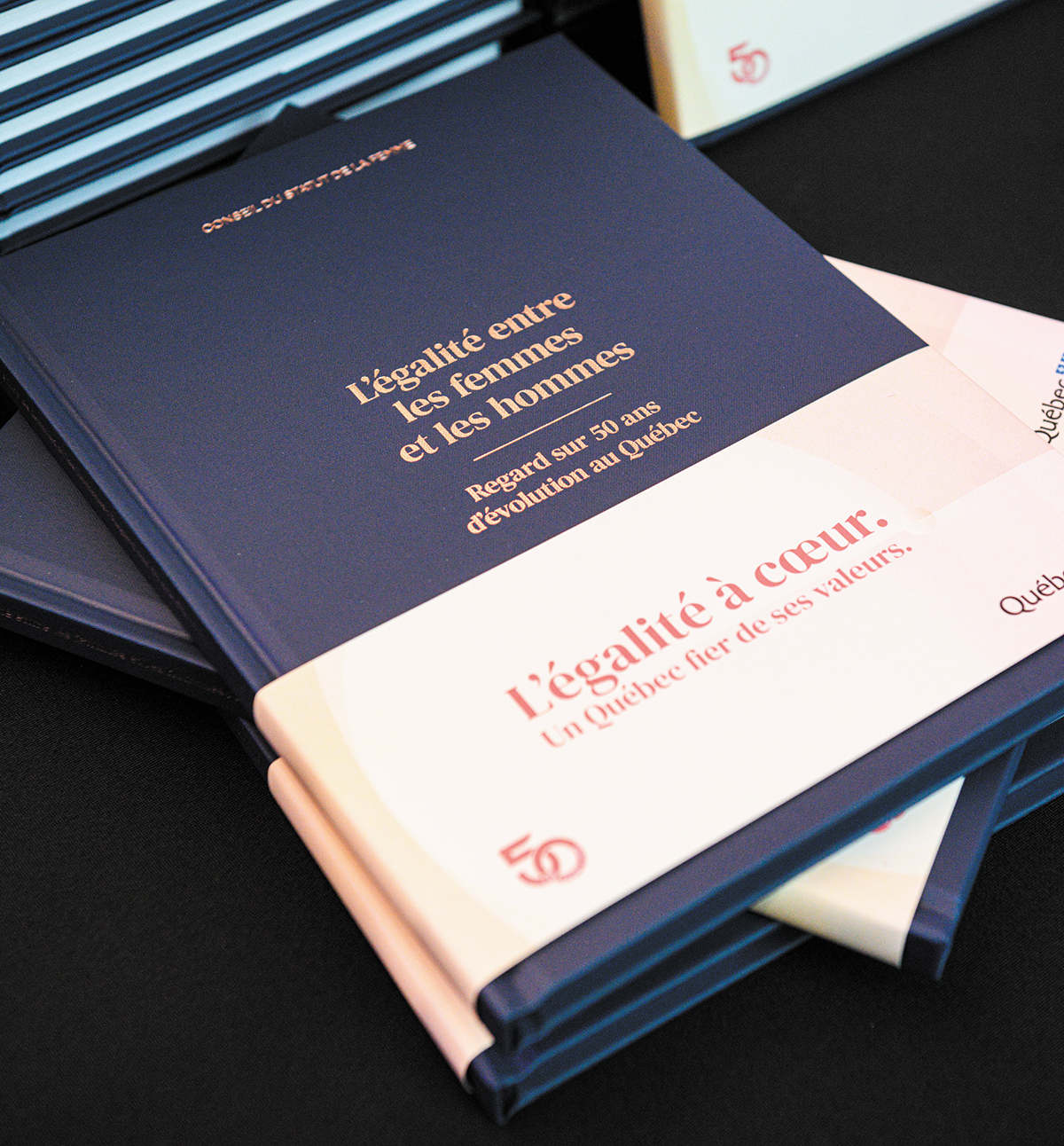
Loisirs, création artistique et pouvoir
En 1978, le CSF dénonce les inégalités entre les sexes dans les loisirs, la création artistique et les lieux de pouvoir. Concernant les loisirs, le CSF critique le manque de temps libre des femmes, souvent limité par les responsabilités domestiques, et l’offre de loisirs, jugée stéréotypée et peu adaptée à leurs réalités. Il recommande des actions pour rendre les loisirs plus accessibles et diversifiés pour les femmes. Encore aujourd’hui, nous constatons que les femmes consacrent moins de temps aux loisirs que les hommes.
Quant à la création artistique, le CSF critique la discrimination systématique à l’égard des femmes, soulignant les difficultés à concilier création, famille et travail. Il constate aussi leur marginalisation dans les domaines littéraire, théâtral et musical. Malgré des progrès, des inégalités persistent dans ces domaines.
En 1978, le Conseil avait choisi de traiter du « pouvoir » dans le même chapitre que les loisirs et la création artistique. C’est dire à quel point les femmes étaient quasi absentes de la vie politique.
Depuis, des lois ont été adoptées afin d’assurer la parité au sein des conseils d’administration des sociétés d’État (2006) et de la magistrature (2012). La zone paritaire est atteinte en 2018 à l’Assemblée nationale (40 % en 2018 et 43 % en 2022). Cependant, les femmes demeurent sous-représentées en politique municipale (24 % de mairesses et 37 % de conseillères municipales en 2021).
Ce bref survol de 50 années d’évolution en matière d’égalité donne un aperçu du travail remarquable de nos prédécesseures.
Bien que des progrès importants aient été réalisés en matière d’égalité au Québec, il reste beaucoup à faire. Des avancées importantes ont été accomplies dans de nombreux domaines, mais des inégalités, parfois invisibles, persistent. Des défis touchent particulièrement les femmes racisées, autochtones ou en situation de handicap, tandis que de nouvelles formes d’inégalités, notamment numériques, émergent. Le CSF, fort de son engagement depuis 1973, poursuit sa mission avec conviction, appelant chaque citoyenne et chaque citoyen à participer activement à la construction d’une société plus équitable et à faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une valeur fondamentale de la société québécoise.


